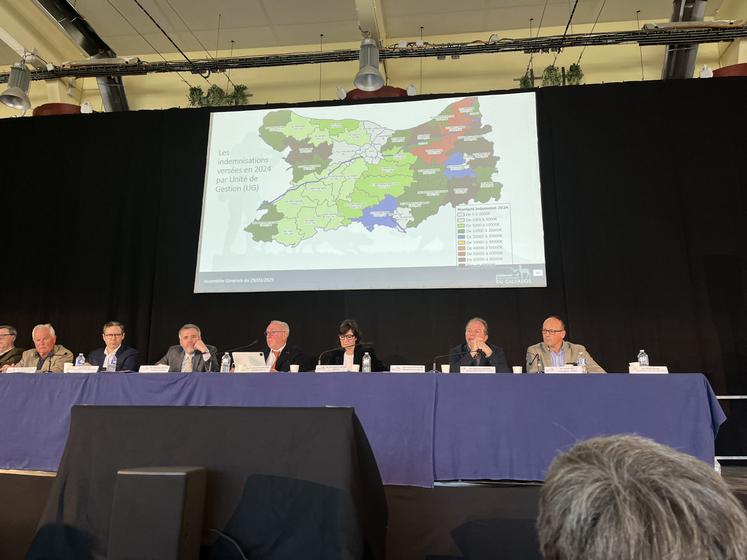Vaches laitières
Des bases rénovées pour l’alimentation
L’INRA vient de publier ce printemps une nouvelle version des tables d’alimentation des ruminants. Sans révolutionner l’approche alimentaire française, reconnue au niveau internationale, plusieurs nouveautés permettent d’être encore plus performant en matière de rationnement.

Meilleure appréciation de l’ingestion des vaches laitières
Si l’appréciation du besoin alimentaire se base toujours sur la production laitière, cependant, retenons, que le niveau de production n’explique que 60% des variations d’ingestion observées, et ce d’autant plus que la ration ne permet pas d’exprimer le potentiel, ce qui est couramment observé en élevage. C’est pour cela que la base reste la capacité de synthèse au niveau de la mamelle. C’est bien ce potentiel,qui guide les quantités ingérées et la production laitière. Le niveau génétique et le développement de la mamelle sont les facteurs qui déterminent ce potentiel. Le raisonnement s’appuie donc non plus sur la production observée mais sur la production potentielle (alimentation non limitante et équilibrée) qui peut être calée sur la production au pic de lactation ou sur le niveau d’étable.
Et quelques nouveautés pour compléter cette estimation de l’ingestion
Autre nouveauté, la note d’état corporel est prise en compte pour évaluer l’ingestion. Son influence est en effet non négligeable, elle est utile quand l’état de l’animal varie au cours de la lactation.
Son impact a été ainsi quantifié : l’ingestion, exprimée en unité d’encombrement laitier (UEL), diminue de 1,5 UEL quand l’état augmente d’un point (échelle de 0 à 5).
Le poids de l’animal reste toujours pris en compte et son impact augmente car il cumule le format de l’animal et sa note d’état corporelle.
De nouveaux facteurs viennent nuancer cette capacité d’ingestion :
-l’âge, exprimé sous forme d’indice de maturité,qui traduit l’évolution de la capacité d’ingestion notamment pour les primipares selon qu’elles vêlent à 2 ou 3 ans.
-le stade de gestation, qui va diminuer petit à petit les volumes consommés.
-l’indice de lactation, qui décrit les capacités d’ingestion différentes entre primipares et multipares en début de lactation.
Pour la simplification des calculs et la prise en compre de l’ensmeble des éléments précédents, l’INRA propsoe des formules et des tableaux synthétiques pour faciliter l’estimation de l’ingestion.
Besoins en énergie : plus de précisions pour le début de lactation
L’encombrement des aliments concentrés dépend essentiellement du taux de substitution. Celui-ci mesure la quantité de fourrage consommée en moins lorsqu’on ajoute un kilo de concentré dans la ration. Il est particulièrement sensible en début de lactation, notamment pour les apports d’énergie, quand les quantités de concentrés peuvent être conséquentes. Ainsi les interactions digestives liées à la proportion de concentrés ont été estimées entre 0 et 2 UFL par jour. D’autre part la mobilisation des réserves peut être maintenant évaluée lorsque la production laitière, la note d’état au vêlage et la semaine de lactation sont connues. Cette mobilisation couvre 100 à 300 UFL au cours des trois premiers mois de lactation et donc permet d’épargner les apports en concentrés. Cela se traduit par une couverture des besoins en fin de 3e mois de lactation pour les hautes productrices. Cet apport est à déduire des besoins calculés par animal.
Enfin, un indice d’activité permet de distinguer les besoins supplémentaires selon la situation, stabulation ou pâturage.
Une évolution minérale notable pour les macro - éléments
La nouvelle approche reprend la notion de minéral absorbable, introduite depuis 2002 avec l’élément phosphore. Entre le minéral ingéré et la part qui est réellement absorbée par l’organisme, il existe un écart qui est lié au type d’aliment. En effet, tous les aliments n’ont pas la même efficacité pour l’utilisation digestive des minéraux. Cette dernière notion est ainsi traduite par un coefficient d’absorption réelle (CAR), chaque aliment est maintenant caractérisé par une valeur Ca et de P absorbable. Cette approche, plus précise, a amené une révision des quantités distribuées en phosphore notamment. Avec ces nouvelles recommandations, attention à l’excès de phosphore et l’utilisation de carbonate est souvent indispensable. Les raisonnements à partir des rapports Ca/P doivent donc évoluer. Il convient dorénavant de bien préciser les valeurs annoncées : parle-t-on en teneur totale (analyse) ou bien en absorbable, qui est le plus logique.
Tout en précisant les apports et les besoins en minéraux
Concernant les apports par les fourrages, les valeurs ont été actualisées et l’effet le plus marquant est une baisse significative des valeurs du maïs ensilage: teneur P = 1,8g/kg ; Pabs = 1,3g/kg ; teneur Ca = 2,0 ; teneur Ca abs = 0,8 g/kg. Les maïs normands analysés au LANO s’affichent avec des teneurs moyennes de 1,9g P et 2,0g Ca. Les besoins des bovins ont été réévalués pour le magnésium et le cobalt,et restent inchangés pour les autres minéraux (potassium, sodium, chlore, soufre, manganèse, iode, sélénium).
De leur côté les besoins en vitamines ont été aussi légèrement réévalués et sont modulés selon la part de concentré dans la ration. Ils s’appuient sur les recommandations américaines du NRC.
Et le caractère "acidogène" de chaque aliment
La notion de sécurité vis-à-vis de l’acidose métabolique (sanguine) est renforcée avec l’appréciation du caractère "acidogène" d’un aliment liée à sa composition minérale. Ceci s’exprime avec la valeur BACA (bilan alimentaire anion cation) ou bien bilan électrolytique (BE). Ce dernier, basé sur le potassium, le sodium et le chlore est plus facile pour une utilisation courante. Les valeurs pour chaque aliment permettent ainsi de calculer un risque éventuel pour la ration.
Pour des stades clés, des objectifs sont précisés : BE inférieur à 50 en fin de gestation et deux premières semaines de lactation, autour de 250 par la suite. C’est un indicateur supplémentaire dans le diagnostic d’une acidose métabolique et pour la prévention des fièvres de lait.
De nombreuses informations sur les valeurs des aliments
Même si des mises à jour, sur les matières premières par exemple, existaient depuis la parution du livre vert de l’INRA at AZF en 2002, une compilation des dernières connaissances a permis d’enrichir ces valeurs dans ce livre rouge 2007. Les nouveautés concernent particulièrement:
- des valeurs pour l’enrubannage,
- la mise à jour des valeurs pour le maïs, notamment un encombrement revu à la baisse et des valeurs minérales et PDIN plus conformes à aux données actuelles relevées sur le terrain,
- une meilleure estimation des valeurs PDI,
- et un nombre de critères plus nombreux (plus de 60 critères par aliment), au-delà des valeurs classiques de composition et de valeurs alimentaires, nous retrouvons les données concernant les parois ( NDF, ADF, ADL), la digestibilité des composants de l’aliment, l’ensemble des minéraux et vitamines, le bilan électrolytique, les valeurs de tous les acides aminés digestibles.
Pour en savoir plus :
Alimentation des bovins, ovins et caprins, tables Inra 2007 éditions Quae.