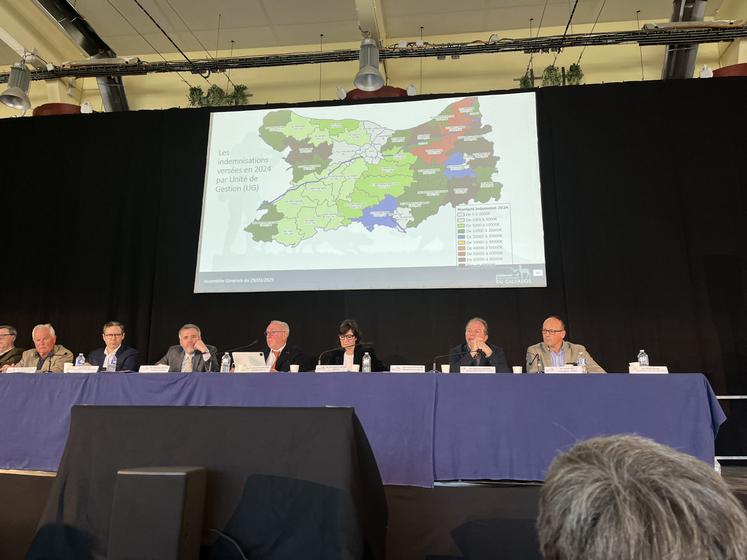FERME DEPHY : s’appuyer sur des collectifs pour repenser ses pratiques et avancer dans ses projets
Colin Georges, exploitant laitier à Montchauvet (14), nous parle de sa conversion à l’agriculture biologique
et de son entrée dans le réseau Ferme Dephy animé par Arnaud Langlois de la Chambre d’agriculture du Calvados. Témoignage.

Pourriez-vous décrire votre exploitation ?
Je me suis installé le 1er novembre 2013 et j'ai été rejoint par ma compagne, Lucie, début mars 2016. On a démarré la conversion bio le 15 mai dernier. Notre exploitation comprend 170 hectares dont actuellement 130 ha d’herbe, 75 vaches laitières de races diversifiées et 75 brebis.
Dès le début, l'objectif était de travailler le plus possible avec de l'herbe pâturée. On a rejoint un groupe d'éleveurs animé par le réseau CIVAM qui est tourné vers l'agriculture durable. Avec eux, on a monté un système de pâturage tournant : on fait pâturer les animaux deux jours sur chaque parcelle d’environ 1,5 ha et on laisse toujours un temps de repousse de 3 à 6 semaines sur chaque parcelle.
Pourquoi avez-vous choisi de vous convertir à l’agriculture biologique ?
En mettant en place un système comme celui-ci, les intrants ont diminué. Par ailleurs, on n’était pas vraiment passionné par l'utilisation du pulvérisateur, et dans le groupe CIVAM, il y avait plusieurs éleveurs bio qui nous ont incités à évoluer vers ce mode de production. On s’est rendu compte qu’on collait bien au cahier des charges de l'agriculture bio : avec des vêlages assez groupés au printemps, du pâturage tournant, on achetait de moins en moins de concentrés. Nous avions aussi peu de cultures telle que le maïs qui demandent des intrants, on s’est donc dit « on le fait, on passe en bio » ! C’est une démarche qui nous a conduits à une conversion assez naturellement. Il y a un coût à la certification, mais au moins on est reconnu pour nos pratiques.
C’est aussi beaucoup plus facile de parler de son métier si l’on n’utilise pas les produits phytosanitaires. Des agriculteurs que j'ai rencontrés se sentaient accusés par certains voisins du fait de leur passage de pulvérisateur proche des maisons. Personnellement, je comprends les personnes qui s’en vont de leur terrasse lorsque l’on arrive avec un pulvérisateur. Les attentes sociétales changent en ce moment.
Quel a été l’élément déclencheur de votre conversion ?
Si le prix du lait conventionnel avait été sur des bases comme en 2014, nous aurions peut-être attendu. Plutôt que de passer du temps à réfléchir aux mesures agro-environnementales et comme on était proche du bio, nous avons donc sauté le pas !
Quelles pratiques avez-vous mises en place et quelles difficultés éventuelles avez-vous rencontrées ?
L’assolement bouge depuis 3 ans : initialement il y avait du blé, du colza, du maïs, j’ai arrêté cela. J’ai arrêté le triticale pur pour des mélanges de céréales (triticale, avoine, épeautre). J’ai aussi fait cette année un mélange de protéagineux pois féverole, mais il y a eu du salissement. Ce n’est pas le mélange le plus évident puisqu’il y a une différence de maturité entre les deux espèces pour la récolte : quand le pois est mûr la féverole est encore verte et cette année cette différence a été plus forte pour des raisons climatiques. Si j’avais mis mon mélange de protéagineux avec une céréale qui couvre bien comme le triticale, cela n’aurait pas été aussi sale.
Je pratique le travail semi-simplifié du sol. Pour semer j’emploie le semis direct, sans les produits phytos le semis direct risque d’être encore plus compliqué en bio. Le problème dans notre région est que nous récoltons les céréales assez tard, le temps de récolter la paille pour les animaux on se retrouve à semer des couverts début septembre au plus tôt. En théorie, quand on fait du semis direct on doit avoir un couvert bien haut pour que quand on le roule et qu’on sème au travers il serve vraiment de couverture et qu’il limite les adventices, mais ça je n’arrive pas toujours à l’avoir.
Les adventices, on les voit moins comme un inconvénient qu’avant : une parcelle de mélange est un peu sale et puis voilà. C’est moins préjudiciable que si l’on veut vendre du blé panifiable. Le salissement est-il vraiment un facteur limitant du bio dans notre exploitation d’élevage ? L’élevage a quand même des avantages : si besoin, on fait trois ans de prairie temporaire avec assez de trèfle. C’est aussi pour cela qu’il y a beaucoup de céréaliers qui réfléchissent à réintroduire l’élevage.
Et l’élevage ?
Ma compagne s’est formée à l’acupuncture et à l’aromathérapie. On vient d’acheter une boîte d’aiguilles, et des huiles essentielles. Quand on achète des aiguilles, ça ne peut pas faire de mal au porte-monnaie, alors que si l’on achète un flacon d’antibiotiques, c’est vite 100 €. En bio, on a le droit à trois traitements en tout (antibio et/ou vermifuges) par an par animal, on était déjà sur cette cadence-là. C’est aussi le système qui fait cela, peut-être que sur un élevage à 10 000 l de lait par vache, il faut intervenir dès qu’un petit pic de fièvre apparaît, ici on a un objectif de 5 500 l (soit la moitié) et aussi presque moitié moins de problèmes : on a très peu de soins aux pattes, très peu de taille de pattes puisqu’elles ont accès au pâturage, nous avons réduit les problèmes liés aux bâtiments et aux concentrations d’animaux, il y a moins de développement et de transmission des maladies.
La difficulté est dans la gestion de l’herbe, par exemple cette année c’était délicat, les vaches chutaient en lait. Le système dépend de l’herbe et donc du climat, et si l’année avait été plus fourragère nous aurions pu faire 30 000 l de lait en plus pour les mêmes charges et le même boulot, ce qui n’est pas négligeable. La maîtrise repose un peu sur nous. On met en place les bons leviers, par exemple quand cela s’est mis à sécher, il fallait diminuer le nombre d’animaux, distribuer du stock au bon moment. C’est pour ça qu’il faut être en groupe avec des éleveurs qui sont confrontés à peu près aux mêmes problèmes au même moment, piocher des idées ou des trucs à ne pas faire, c’est indispensable.
Pourquoi avez-vous choisi de rentrer dans le réseau Ferme Dephy ?
Sur notre carrière, nous ne pouvons faire qu’un nombre d’essais limité, le partage d’expériences m’intéresse. Ce réseau est un peu le nouveau groupe culture : avant j’allais en groupe culture pour échanger sur les phytos et les engrais etc. ; et lors de ma première réunion de groupe Dephy nous avons surtout vu des résultats d’essais sur les mélanges de céréales, de céréales-protéagineux, de protéagineux ensemble, à ensiler, à récolter en grain, enfin tout sur les cultures destinées à l’élevage. Nous avons aussi discuté des débouchés.
L’après-midi, on est allé sur la ferme Reine Mathilde et nous avons participé à des ateliers. On a échangé avec d’autres agriculteurs du réseau Dephy. On a mangé ensemble le midi et ça s’est très bien passé. Je crois beaucoup aux échanges entre agriculteurs. C’est tout bon quand on échange des expériences, on échange sur ce qui a marché à tour de rôle. Les animateurs sont indispensables pour faire fonctionner le groupe et amener des éléments techniques, et le temps des échanges est un moment riche.
Les jours passés en formation (Dephy ou autre) doivent être pris comme un investissement. Il y a un risque à rester enfermé chez soi.
Quels conseils donneriez-vous aux agriculteurs qui souhaitent passer en bio ?
Réfléchir à son système à l’avance : ne pas dire je vais faire la même chose mais en bio. Pour l’éleveur laitier, l’agriculture biologique va venir naturellement si l’on travaille avec du pâturage au maximum : les quantités d’antibiotiques vont baisser, de même pour les concentrés, ils vont vouloir planter des haies pour avoir des abris.