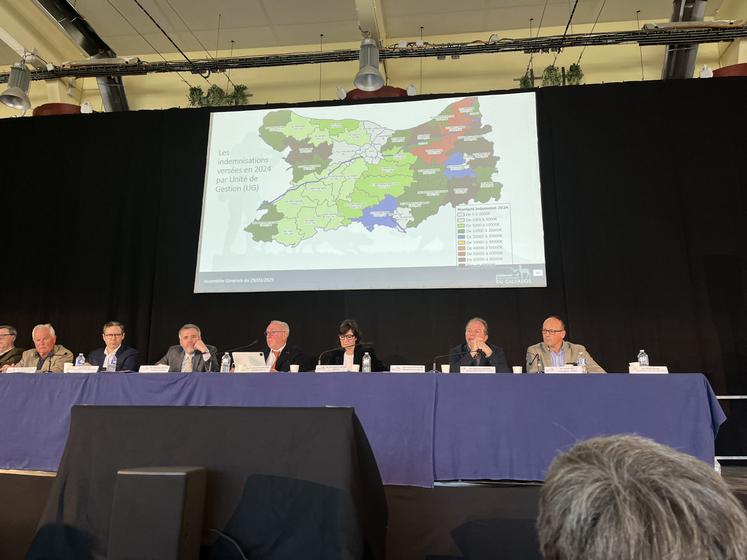Jean-Charles Bocquet, Directeur de l’UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes)
La politique l’emporte sur le scientifique
Jean-Charles Bocquet, Directeur de l’UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes)
Les produits phytopharmaceutiques font l'objet de dossiers à charges. Parole à la défense.

Il est encore temps d’agir. L’ensemble des acteurs doit se mobiliser. Nous devons convaincre les services de l’Etat, les ministères concernés, les députés Européens et Français, les politiques locaux mais aussi les consommateurs du danger de ce que Bruxelles mitonne.
©
TG
Bruxelles revoit le cadre réglementaire des produits phytopharmaceutiques. Où en sommes-nous précisément ?
Deux textes sont en discussion. D’une part la révision de la directive 91/414 spécifique à l’évaluation des produits phytopharmaceutiques avant leur autorisation de mise sur le marché. D’autre part, un projet de directive sur l’utilisation durable des pesticides.
La directive 91/414 va être transformée en règlement. Plutôt une bonne nouvelle ?
Effectivement, puisque cela signifie que tous les états membres devront l’appliquer sans distinguo évitant ainsi les distorsions de concurrence auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui en France. Je pense aussi aux produits homologués dans les pays voisins et les conséquences induites comme l’importation illicite.
Quelles conséquences de ces réformes ?
Elles concernent l’industrie, les agriculteurs mais aussi les consommateurs. Potentiellement et si le texte sorti du Parlement de Strasbourg est appliqué, on va éliminer 60 à 70 % des molécules existant aujourd’hui sur le marché. Ce qui signifie que sur certaines productions, en particulier les fruits et légumes, on va se retrouver sans solution chimique.
Avec un risque partiel de délocalisation de notre agriculture ?
Bien sûr. Par exemple, nous pourrions être contraints d’importer nos fruits et légumes d’Afrique, de Chine voire même d’Amérique Latine. Pays qui ne seraient pas soumis à ces contraintes.
Le développement de l’AB (Agriculture Biologique) n’est-il pas la solution ?
Même avec un objectif de 20% des surfaces cultivées fixé par le Grenelle de l’environnement, la démarche AB ne suffira pas à compenser cette perte de molécules.
Et les biotechnologies ?
Sur un plan technique, certainement. Mais les dernières décisions du Gouvernement, en déclenchant la clause de sauvegarde sur le dossier du maïs Mon 810, sont éloquentes. Les considérations politiques et sociétales l’ont emporté sur les considérations scientifiques. Preuve en est avec la démission de certains membres du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM.
Vous évoquiez le Grenelle de l’environnement, quelle est votre analyse ?
Il ajoute un étage supérieur à la fusée avec l’élimination arbitraire de 53 substances. Il fixe aussi un objectif de réduction de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires s’il y a mise au point de solutions alternatives.
Vous semblez sceptique ?
Soyons sérieux. Depuis 30 ans que je suis dans le métier, j’entends parler de solutions alternatives. Elles sont intéressantes sur le plan intellectuel mais limitées au point de vue pratique. Cet objectif est irréaliste.
Mais que proposez-vous ?
L’UIPP privilégie une diminution de l’impact des traitements. En d’autres termes : accentuer les efforts sur les bonnes pratiques, sur les solutions innovantes, sur les molécules disponibles à l’étranger mais pas en France.
La morale de cette histoire n’est-elle pas que l’on subit un violent retour de balancier de pratiques agricoles qui se seraient défiées trop longtemps de considérations environnementales ?
Les agriculteurs ont toujours pris en considération la composante environnementale. N’oublions cependant pas qu’au lendemain de la guerre, on leur a demandé de produire et produire encore plus. Ils ont rempli leur mission à 200%. La France, non seulement est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire, mais elle s’est même hissée au rang de seconde puissance agricole au monde. Certes, peut-être à un moment donné avons-nous insuffisamment pesé l’aspect environnement. Mais les agriculteurs ont utilisé des produits évalués et homologués qui ne présentaient aucun risque sous condition du respect des règles d’usage de l’époque spécifiées dans le mode d’emploi.
Pensez-vous qu’aujourd’hui la messe est dite ?
Il est encore temps d’agir. L’ensemble des acteurs doit se mobiliser. Nous devons convaincre les services de l’Etat, les ministères concernés, les députés Européens et Français, les politiques locaux mais aussi les consommateurs du danger de ce que Bruxelles mitonne. Car in fine, c’est le consommateur qui va trinquer. Il risque de payer ses fruits et légumes, voire même son pain, plus cher dans des conditions de production que nous ne maîtriserions plus.
Propos recueillis par Th. Guillemot
Deux textes sont en discussion. D’une part la révision de la directive 91/414 spécifique à l’évaluation des produits phytopharmaceutiques avant leur autorisation de mise sur le marché. D’autre part, un projet de directive sur l’utilisation durable des pesticides.
La directive 91/414 va être transformée en règlement. Plutôt une bonne nouvelle ?
Effectivement, puisque cela signifie que tous les états membres devront l’appliquer sans distinguo évitant ainsi les distorsions de concurrence auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui en France. Je pense aussi aux produits homologués dans les pays voisins et les conséquences induites comme l’importation illicite.
Quelles conséquences de ces réformes ?
Elles concernent l’industrie, les agriculteurs mais aussi les consommateurs. Potentiellement et si le texte sorti du Parlement de Strasbourg est appliqué, on va éliminer 60 à 70 % des molécules existant aujourd’hui sur le marché. Ce qui signifie que sur certaines productions, en particulier les fruits et légumes, on va se retrouver sans solution chimique.
Avec un risque partiel de délocalisation de notre agriculture ?
Bien sûr. Par exemple, nous pourrions être contraints d’importer nos fruits et légumes d’Afrique, de Chine voire même d’Amérique Latine. Pays qui ne seraient pas soumis à ces contraintes.
Le développement de l’AB (Agriculture Biologique) n’est-il pas la solution ?
Même avec un objectif de 20% des surfaces cultivées fixé par le Grenelle de l’environnement, la démarche AB ne suffira pas à compenser cette perte de molécules.
Et les biotechnologies ?
Sur un plan technique, certainement. Mais les dernières décisions du Gouvernement, en déclenchant la clause de sauvegarde sur le dossier du maïs Mon 810, sont éloquentes. Les considérations politiques et sociétales l’ont emporté sur les considérations scientifiques. Preuve en est avec la démission de certains membres du comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM.
Vous évoquiez le Grenelle de l’environnement, quelle est votre analyse ?
Il ajoute un étage supérieur à la fusée avec l’élimination arbitraire de 53 substances. Il fixe aussi un objectif de réduction de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires s’il y a mise au point de solutions alternatives.
Vous semblez sceptique ?
Soyons sérieux. Depuis 30 ans que je suis dans le métier, j’entends parler de solutions alternatives. Elles sont intéressantes sur le plan intellectuel mais limitées au point de vue pratique. Cet objectif est irréaliste.
Mais que proposez-vous ?
L’UIPP privilégie une diminution de l’impact des traitements. En d’autres termes : accentuer les efforts sur les bonnes pratiques, sur les solutions innovantes, sur les molécules disponibles à l’étranger mais pas en France.
La morale de cette histoire n’est-elle pas que l’on subit un violent retour de balancier de pratiques agricoles qui se seraient défiées trop longtemps de considérations environnementales ?
Les agriculteurs ont toujours pris en considération la composante environnementale. N’oublions cependant pas qu’au lendemain de la guerre, on leur a demandé de produire et produire encore plus. Ils ont rempli leur mission à 200%. La France, non seulement est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire, mais elle s’est même hissée au rang de seconde puissance agricole au monde. Certes, peut-être à un moment donné avons-nous insuffisamment pesé l’aspect environnement. Mais les agriculteurs ont utilisé des produits évalués et homologués qui ne présentaient aucun risque sous condition du respect des règles d’usage de l’époque spécifiées dans le mode d’emploi.
Pensez-vous qu’aujourd’hui la messe est dite ?
Il est encore temps d’agir. L’ensemble des acteurs doit se mobiliser. Nous devons convaincre les services de l’Etat, les ministères concernés, les députés Européens et Français, les politiques locaux mais aussi les consommateurs du danger de ce que Bruxelles mitonne. Car in fine, c’est le consommateur qui va trinquer. Il risque de payer ses fruits et légumes, voire même son pain, plus cher dans des conditions de production que nous ne maîtriserions plus.
Propos recueillis par Th. Guillemot