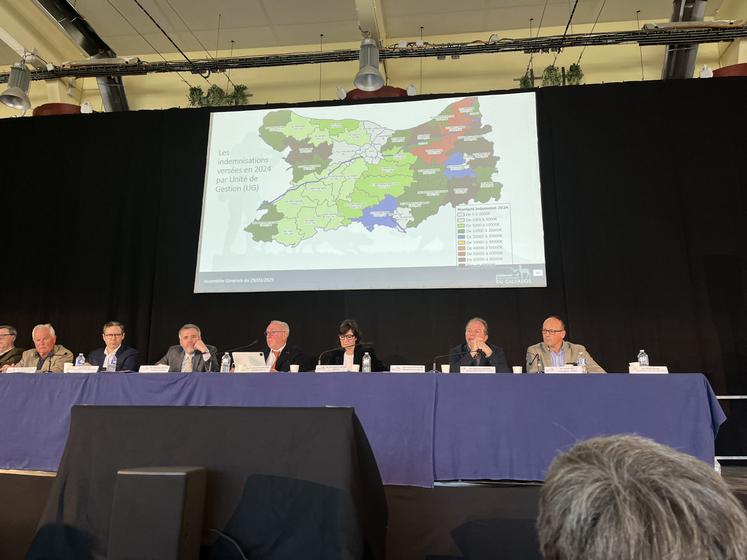Michel Barnier, ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Le Grenelle de l’environnement,
Au lendemain du Grenelle de l’environnement, Michel Barnier, ministre de l’Agriculture explique l’enjeu des objectifs fixés par le président de la République. Dans un interview accordé à Réussir, il précise aussi les évolutions souhaitées par la France pour la réforme de la Pac.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé ce Grenelle ?
Ce n’est pas un hasard si la réussite du Grenelle a été rendue possible avec l’agriculture et non pas contre elle ou sans elle. La question climatique est, je crois, le défi le plus important, le plus grave et le plus global pour nous tous. Les agriculteurs, en particulier, sont les premiers touchés par le réchauffement climatique. Lorsque j’étais ministre de l’environnement, j’avais dit publiquement qu’ils étaient les premiers écologistes de France même si il y a des pratiques à faire évoluer.
Dès le départ, j’ai donc voulu que l’agriculture se mette en initiative. Je l’ai dit à mes équipes comme aux dirigeants agricoles. C’est une volonté délibérée, sincère. Avec le Grenelle, on arrive à un socle sur lequel on peut bâtir une nouvelle PAC. Je rends hommage à l’intelligence des dirigeants agricoles car ils ont compris l’enjeu du Grenelle pour ce secteur. J’ai proposé quatre plans qui sont les seuls plans annexés aux conclusions du Grenelle. Ils constituent des bases sur lesquelles nous allons discuter.
L’agriculture conventionnelle n’est-elle pas finalement malmenée par le contenu du discours de Nicolas Sarkozy ?
Nicolas Sarkozy a clairement marqué une inflexion que nous souhaitons nous mêmes, vers
une agriculture de production, durable et non pas productiviste. Je n’ai pas de problème avec cela. J’en ai souvent parlé avec le président de la République.
C’est une grande évolution mais elle est nécessaire. Sinon, on risque de retrouver un clivage, une opposition entre la société et l’agriculture. L’agriculture en tant qu’activité économique utilise essentiellement des éléments naturels. Mais il s’agit de ressources qui ne sont pas gratuites et qui sont épuisables, que l’on grignote petit à petit. Les paysans en sont les premiers comptables. Ils doivent faire attention aux usages qu’ils font de certains produits, de l’eau par exemple. Il ne faut pas sacrifier l’avenir au présent comme disait Pierre Mendès France.
On demande aux céréaliers de produire plus et en même temps d’utiliser moins de produits agrochimiques ? Comment résolvez-vous cette contradiction ?
Chacun est dans son rôle. Vous avez des industriels qui se sont exprimés plus que des exploitants agricoles de grandes cultures. Ceux-là ont protesté contre telle ou telle norme ou telle réduction d’usage des produits.
Dans la décision qui a été prise de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides, il y a une prudence économique qui consiste à dire que l’on devra proposer au fur et à mesure des produits et des méthodes de substitution. Je vais moi-même présider la première réunion d’un groupe de travail interministériel sur les phytosanitaires. Il sera mis en place dans les jours qui viennent. Il sera composé de ceux qui sont partie prenante sur ce sujet : les dirigeants agricoles, la recherche, les administrations, ministères de l’agriculture, de la santé, de l’environnement, des finances ainsi que des industriels. L’intérêt général l’emportera sur les intérêts particuliers.
Vous ne craignez pas les résistances du monde agricole sur ce sujet extrêmement sensible ?
Cela sera compliqué et difficile. Mais les agriculteurs utilisent les pesticides par nécessité, pas par plaisir. De plus, on n’est pas allé au bout des possibilités qu’offre la recherche. Il y a des marges de progression dans ce domaine. Ce dispositif inclura aussi un volet formation. Celle-ci commence dans les établissements dont j’ai la responsabilité. Comme vous le voyez, je compte m’occuper personnellement de ce plan, m’y impliquer fortement. Je considère que j’en suis comptable.
Faut-il augmenter les crédits de la recherche ?
Il faut les augmenter et les réorienter. On va regarder culture par culture, parasite par parasite, région par région. J’ai déjà annoncé le calendrier de la suppression des 47 molécules les plus dangereuses interdites sous 5 ans. Trente le seront l’année prochaine, dix en 2010 et le reste en 2012. La liste est connue. Nous allons réussir que cela plaise ou non à certains industriels.
Le président a introduit un « si possible » dans le calendrier à 10 ans pour la réduction des phytos qui a rassuré les agriculteurs et semé le doute dans l’esprit des écologistes…
Ce « si possible » signifie qu’on ne mettra pas en cause la viabilité économique des exploitations. Si cet été nous n’avions pas pu lutter contre le mildiou, il n’y aurait pas eu de récolte de pommes de terre. En ce qui concerne le délai, je veux même faire mieux que les 10 ans prévus et je souhaite que le « si possible » disparaisse. Je suis très volontariste sur cette question. Je vais m’impliquer dans la réussite de ce plan avec tous ceux qui peuvent y contribuer. Je suis prêt à accepter tous les raisonnements dès l’instant où ils sont sincères et guidés par le souci de l’intérêt général. Et l’intérêt général, du point de vue des consommateurs, de la santé publique, de l’environnement, du revenu des agriculteurs, est que l’on utilise le moins de produits de cette nature. L’industrie phytopharmaceutique doit participer à ce chantier. Je vais les réunir et les consulter.
Ce plan va vous réconcilier avec les céréaliers ?
Je n’ai pas l’impression que c’était avec moi qu’ils étaient en froid. En tout cas, on est partis pour un long dialogue qui sera conduit de manière objective. Les céréaliers sont au cœur de la force de production française, de ce que nous exportons. Il faut qu’ils évoluent mais on ne va pas les décourager.
Est-il possible, avec ce plan, de continuer à augmenter les rendements ?
Je le crois. Et de toute façon nous n’avons pas le choix. Dans le moyen et long terme, la force et la qualité de ces productions est qu’elles soient plus respectueuses de l’environnement. Mais on va faire cette agriculture durable avec eux et non pas contre eux.
Nicolas Sarkozy a annoncé un gel des cultures commerciales OGM. Allez-vous demander la clause de sauvegarde à Bruxelles et a-t-on des arguments scientifiques nouveaux pour appuyer cette demande ?
Il y a, du côté de la Commission européenne, un nouvel état d’esprit. Le commissaire européen chargé de l’environnement, Stavros Dimas, vient lui-même, pour la première fois, d’émettre des doutes à l’occasion de l’autorisation de deux maïs OGM sur laquelle, moi-même je me suis abstenu, il y a quelques semaines.
Les doutes exprimés par le président de la République sont donc partagés, ce qui est nouveau. La demande d’arguments scientifiques supplémentaires fera partie du travail d’évaluation en ce qui concerne surtout le maïs Mon 810, celui-là même qui est visé par l’annonce du gel de la part du président de la République. Il est le seul utilisé en France et sa réévaluation est prévue à partir d’avril prochain. D’ici là nous allons constituer une haute autorité de l’environnement en regroupant des instances d’évaluation. Il y aura également une loi pour encadrer la coexistence des cultures et sécuriser les décisions. En ce qui concerne ces cultures, le président a dit très clairement qu’il n’acceptera pas que l’on mette en cause la propriété d’autrui… Mais, il faut aussi qu’il n’y ait pas de contestation. Cela veut dire qu’il faut plus de force et d’indépendance de la part des instances d’évaluation. Cela implique aussi qu’il faut une loi qui, après un débat public, donne des garanties pour que les décisions prises soient respectées.
Ce calendrier permettra-t-il d’arriver à une loi avant les achats de semences pour les prochains semis ?
On va tout faire pour cela. Mais évidemment, j’ai un point d’incertitude sur la durée de l’évaluation scientifique. Je ne peux pas vous dire, aujourd’hui, que tout cela sera réglé en février. Je pense que ceux qui produisent ces OGM, ceux qui les utilisent et qui ont besoin de commander leurs semences avant de les mettre en terre, ont des raisons pour dire qu’il faut aller vite. Ils ont besoin de réponses. Nous allons essayer de conduire tout cela rapidement, mais je ne peux pas garantir le temps de cette évaluation.
Comment arbitrer entre les exigences environnementales et les demandes des producteurs de grandes cultures, celle des céréaliers surtout ?
D’abord, tous les céréaliers ne sont pas demandeurs d’OGM. Les pro-OGM seront évidemment écoutés dans le débat. Mais ce qu’il faut qu’ils comprennent, c’est que, lorsque l’on travaille dans la nature, lorsque l’on produit dans un environnement qui appartient à tout le monde, il faut accepter de répondre aux questions que se pose la société autour de vous. C’est cela qu’ont très bien compris les dirigeants agricoles dans le Grenelle. C’est pour cela que cette rencontre a été un succès. La démocratie moderne exige de débattre et de répondre aux questions.
Quel est votre propre sentiment en ce qui concerne les OGM ?
Il faut un débat plus rationnel et plus ouvert sur les OGM. Nous sommes le seul pays où il y a eu un débat aussi irrationnel sur cette question. Finalement le Grenelle de ce point de vue est un bon début… Dès qu’il y a un débat, des méthodes comme celles de José Bové deviennent dépassées.
Des organisations comme la Confédération paysanne, qui prône des idées assez proches de celles de José Bové, ont vivement regretté de ne pas participer à la dernière table ronde.
Sans doute. Mais pour la dernière réunion, le nombre de participants a dû être assez restreint. Mais les ONG étaient là et défendaient des idées qui auraient pu être mises dans la bouche de la Confédération paysanne. Tous les points de vue se sont exprimés. Et puis ils avaient été associés aux précédents groupes de travail.
Comment expliquez-vous le revirement de l’image, auparavant positive, des biocarburants dans la société ? Nicolas Sarkozy a affirmé qu’il fallait revoir leurs conditions de développement.
Ce revirement est lié d’abord aux questions de prix agricoles, aux problèmes du partage des terres entre alimentation et production énergétique, de même qu’aux difficultés d’utiliser les agrocarburants et biocarburants car il n’y a pas assez de pompes. De plus, le bilan écologique de ces produits peut être assez fortement amélioré. C’est pourquoi l’Ademe va faire une actualisation de ce bilan pour la première génération d’agrocarburants. De toute façon il faut pousser les recherches pour améliorer les bilans énergétiques et écologiques. La deuxième génération va augmenter les rendements par cinq pour la même surface cultivée. Sur ce point, je vais bientôt signer un accord de recherche avec la Suède. Comme l’a dit le président de la République, la clé de l’avenir est dans cette deuxième génération des biocarburants. A observer le prix du baril de pétrole, on voit bien qu’il y a un avenir pour ces produits. Mais ce qui est acquis ne sera pas remis en cause.
Vous avez décidé d’inclure une part plus grande d’écologie dans les assises de l’agriculture que vous préparez, pourquoi ?
Dans le deuxième document de préparation pour les assises de l’agriculture, nous avons en effet intégré une nouvelle dimension environnementale. C’est un aspect, dans le cadre de la préparation de la future Pac, que les agriculteurs doivent s’approprier. Je ne l’imposerai pas malgré eux. L’objectif principal des assises est de préparer, collectivement, la position de la France pour la réforme de la Pac. Je crois au compromis dynamique. Le mot compromis est au cœur de la méthode européenne. Nous sommes dans une politique qui est totalement européenne. Pour l’instant, les politiques nationales, depuis 1958, ne sont que complémentaires. Il suffit de regarder le budget : notre politique agricole est financée à hauteur de dix milliards par Bruxelles et le budget de mon ministère qui comprend la politique d’éducation agricole est de cinq milliards. Les assises doivent nous rendre capables de réagir lorsque la Commission nous demandera de nous prononcer sur plus ou moins de modulation, de plafonnement…
Quelle évolution préconisez-vous pour la Pac ?
La politique agricole commune se sauvera si elle évolue. Les budgets sont stabilisés jusqu’en 2013 et nous y tenons. Après, la question est de savoir comment on fait évoluer les aides directes, car il y a des changements à opérer. Je souhaite trouver des moyens, avant 2013, de mieux aider certaines productions qui ne sont pas traitées de manière équitable. Je parle notamment de l’élevage ovin et pas seulement en termes d’aménagement du territoire mais aussi en termes de production économique. Il faut donc préserver les aides directes car, l’agriculture, c’est de l’économie. Nous parlons d’une politique qui est la première politique de l’Europe ! L’Europe, ce n’est pas un grand super marché avec le maximum de compétitions fiscales et sociales à l’intérieur et le maximum de portes ouvertes à l’extérieur. Nous avons bâti un modèle de mondialisation maîtrisée, avec des régulations, des redistributions, et pas avec de l’ultra-libéralisme. Je suis libéral, mais je pense qu’il faut réguler l’économie. La première preuve de cette régulation, c’est la politique agricole commune.
Vous parlez avec la conviction d’un député européen. Vous verriez-vous en président du parlement européen ?
Je n’ai pas besoin d’être à ce poste pour m’exprimer ainsi avec des idées que j’ai toujours eues. Ce qui est sûr c’est que je me présenterai aux élections européennes de 2009.
Vous avez parlé d’équité, seriez-vous favorable à une régionalisation des aides et un découplage total ?
On attend les propositions de la Commission qui va sans doute proposer de découpler une partie de ce qui ne l’est pas encore, de plafonner, de moduler un peu plus… L’important est de préserver le pilier économique, et à l’intérieur de celui-ci d’enclencher certains redéploiements notamment au profit de certaines productions qui n’ont pas été bien traitées comme la production ovine. Je veux, dans ce premier pilier, trouver les moyens de créer des outils de gestion et de stabilisation des marchés. Car si on diminue certaines aides directes pour tenir compte de l’augmentation des prix dans certains secteurs, on ne peut pas laisser non plus, en même temps, les agriculteurs entièrement soumis aux fluctuations des marchés. Je suis partisan de créer des outils de stabilisation des marchés qui permettent de préserver l’alimentation des citoyens de la seule loi de la spéculation internationale.
D’autres projets peuvent aussi être mis en œuvre, en matière de gestion des crises économiques, sanitaires et climatiques, pour lesquelles nous n’avons pas les bons outils. Dans la nouvelle Pac, nous devons créer ces nouveaux outils.
Vous voulez faire évoluer la nature des aides directes ?
Il y aura des évolutions sur ce sujet qui devront tenir compte de la réalité des revenus. Je veux une politique agricole européenne qui soit à la fois durable et équitable. Les deux mots vont ensemble pour moi. Et, naturellement, sans naïveté, nous maintiendrons même, en la rénovant, la préférence européenne.
Mariann Fischer Boel affirmait ne pas bien comprendre cet objectif de votre part…
Protection ne signifie pas protectionnisme. On veut maintenir un certain nombre de règles et de protections tarifaires et nous voulons créer de vraies protections logiques et rigoureuses en matière sanitaire et écologique. Et dans ce cadre, on peut faire de la coopération pour aider les pays qui exportent vers nous à se mettre aux normes européennes.
Cette réforme a valeur de symbole ?
Un peu. Nous devons préserver le modèle européen d’agriculture. C’est un modèle ancré dans des territoires. Il est à l’opposé de l’intensification généralisée et de l’aseptisation généralisée des produits. Certes la PAC a un coût. Mais quel serait le coût pour l’Europe d’une absence de PAC pour la qualité et la sécurité de la consommation, la vie des territoires ruraux… Il serait bien plus élevé. On ne peut pas laisser toutes les questions de sécurité alimentaire, de cohésion territoriale supportées uniquement par le prix et la consommation. Il y a des raisons d’avoir des politiques publiques dans ces domaines.
Propos recueillis par Hervé Plagnol, Sophie Baudin (AgraPresse) et Hervé Garnier (Réussir).