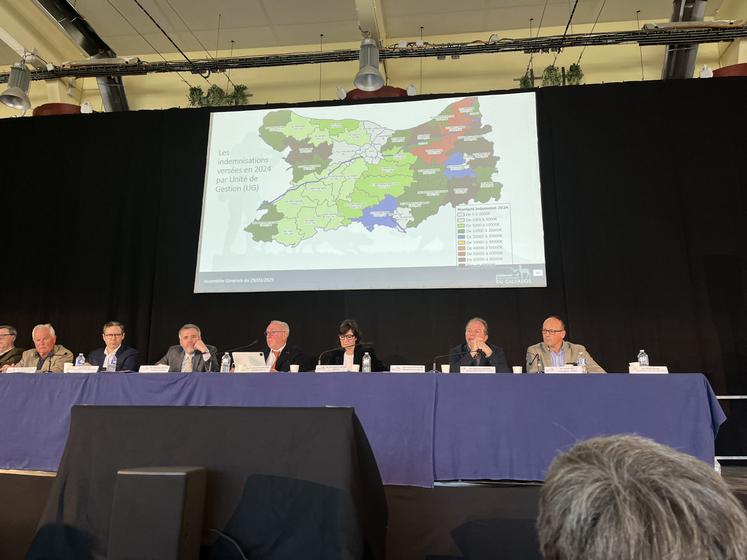Equipement
Le pâturage assurément robot-compatible
Un robot de traite VMS Delaval sous la stabulation, 10 ha de pâturages autour libres d’accès. Une forme d’auto-gestion.



A l’EARL de La Jarriais à Buais (50) pendant la saison de pâturage, les vaches sont interdites d’escapades nocturnes après 21 heures. Ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’elles sont toutes sous la stabulation. En fait, elles peuvent entrer mais la sortie est condamnée.
Circulation contrôlée
C’est là que réside la clé de la réussite du mariage entre le robot de traite et le pâturage. Contrôler la circulation comme maîtres mots ! Et nul besoin de mettre en place une logistique à la “Bison futé” pour gérer les flux sauf peut-être à vouloir pratiquer un pâturage tournant, rationné(...) très pointu. Bernard et Régine Thibert ont fait un autre choix : celui de la simplicité. 10 ha de prairies ouvertes où les laitières vont où elles veulent, quand elles veulent sauf la nuit. “Le matin, après un premier passage au robot, elles sortent une par une à l’herbe, commente notre couple d’éleveurs. Comme les auges sont vides quand elles reviennent en journée pour la traite, elles repartent au pâturage. Par contre, le soir vers 21 h, elles sont maintenues en stabulation avec le maïs à disposition. En hiver, les vaches ne sortent pas. Le désilage du maïs se fait le matin et l’ensilage est repoussé en cours de journée”. Autre point qui a son importance, pas de point d’eau dans les pâtures. Pour boire, il faut repasser en stabulation.
Pas de différence significative
A la question : “les vaches se font-elles moins traire l’été que l’hiver ?” Bernard Thibert hésite avant de lâcher : “peut-être un peu moins mais c’est insignifiant”.
Le rythme de traite en fait dépend plus du niveau de production. “Les fraîches vêlées viennent se faire traire deux à trois fois dans la journée. Les vaches en fin de lactation, c’est plutôt une fois”, fait remarquer Régine Thibert. Au moment du tarissement, les vaches changent de lot ce qui “casse” leurs habitudes.
Quant aux génisses, leur faculté d’adaptation à la traite robotisée ne pose pas de problème même en saison verte. “Elles suivent les vieilles”. Tout simplement !
Le robot fait du social
C’est en août 2003 que l’EARL de La Jarriais s’est robotisée. Six ans plus tard, Régine et Bernard sont confortés dans leur choix stratégique et c’est le volet social qu’ils classent en tête dans la colonne des plus. Amener ou chercher les enfants à l’école et suivre leurs devoirs (même s’ils ont grandi), se jouer de la traite du soir après une sortie dominicale (...), grâce au robot, l’astreinte laitière a changé de visage. Il existe toujours des contraintes (surveillance accrue des animaux, interprétation des données fournies par le robot, maintenance rigoureuse de l’outil...) mais le rapport avec le temps n’est plus le même. Le pâturage libre s’inscrit dans la même veine. Pas de fil à avancer, pas de barrières à ouvrir ou fermer, pas de refus à faucher, pas d’eau à transporter (...), il faut juste accepter de marcher. Est-ce vache ?
Un coût alimentaire particulièrement maîtrisé
• Sur le dernier exercice, l’atelier lait a utilisé 20 ha de maïs et une vingtaine d’ha d’herbe. Avec 50 % de maïs dans la SFP, le coût alimentaire de l’atelier lait (vaches et génisses de renouvellement) s’élève à 83 e/1 000 litres produits (31 e pour la surface fourragère et 52 e pour les concentrés, minéraux et poudre de lait). Ce coût est particulièrement performant tant au niveau de la surface fourragère (313 e de charges opérationnelles/ha y compris les travaux par tiers) que du poste concentré (1 490 kg par VL pour produire 9 200 litres à 7 %). A noter qu’avec 392 000 litres de lait produits sur 40 ha de surface fourragère, la densité laitière est d’un niveau élevé avec près de 9 800 l/ha. Le maintien des performances animales s’est accompagné d’une maîtrise des coûts. Il n’y a pas eu de dérive au niveau du coût de concentré.
V Simonin ca 50