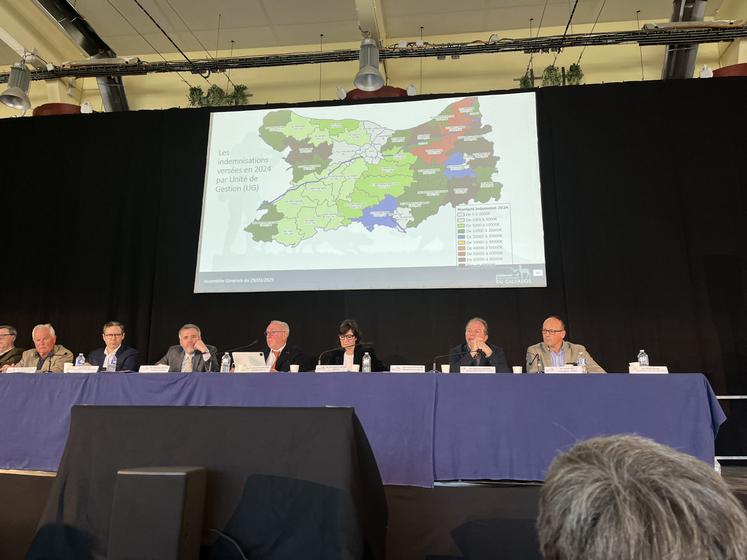Qualité des sols
Premiers résultats du réseau normand
Qualité des sols
La France établit depuis 2001 un réseau de parcelles afin d’effectuer régulièrement des analyses et de surveiller l’évolution de la qualité des sols.

Sol de limon humide du Pays d’Auge (Calvados).
©
DR

Sol sur granite du Cotentin (Manche).

Sol sur schiste du Bocage Ornais (Orne).
En Normandie, les Chambres d’agriculture ont participé à la mise en place de ce réseau. Les premiers résultats sont une meilleure connaissance des sols normands, de leurs contraintes et des risques qui pèsent sur leur qualité future.
Un réseau pour surveiller la qualité des sols
Les sols évoluent lentement sous l'effet du climat, de la végétation,... Néanmoins, leur évolution peut être accélérée par les activités humaines (aménagements fonciers, pollutions ac-cidentelles,....). Des processus, comme l'érosion ou l'acidifica-tion, qui n'affectent pas la production à court terme sont parfois néfastes à long terme. Aujourd'hui, l'Europe souhaite prendre en compte les sols dans les politiques environnementales. Afin d'évaluer l'état actuel des sols et surveiller leur évolution, les scientifiques ont décidé de suivre un réseau de parcelles. Une collaboration scientifique entre l'Inra et les Chambres d'agricul-ture depuis 2005 a permis de mettre en place ce réseau de mesures de la qualité des sols en Normandie.
Le réseau est mis en place sur la France entière avec 1 600 sites répartis sur un maillage de 16 km de côté. Ainsi, 108 sites couvrent la Normandie (voir carte). Les sites peuvent aussi bien se situer en culture, en prairie ou encore dans un bois. Les prélèvements de terre pour analyse (en surface et en profondeur) sont accompagnés d’une observation très détaillée en fosse et d’un questionnaire sur l’exploitation de la parcelle. Tous les résultats sont anonymes, ils sont intégrés dans la base de données nationale. Les échantillons de terre prélevés sont envoyés à analyser à l'Inra d'Orléans. Les analyses portent sur la granulométrie, le pH, les éléments fertilisants, les métaux lourds. Les mesures seront réalisées tous les 8 ans pour surveiller l'évolution des teneurs. L'objectif est de faire un bilan de la qualité des sols et de la suivre à long terme pour éviter leur dégradation (acidification, perte de fertilité…).
Un panorama des terres normandes
Le premier résultat de l’étude des 108 sites du réseau est un panorama détaillé des terres normandes, qui permet de mieux connaître les sols de la région (Graphique 1).
Dans le réseau, les sols de limons confirment leur importance en Normandie : on les retrouve dans près de 30 % des sites. Cependant, leur répartition est inégale, ils sont presque absents des sites de l’Orne. Du point de vue de la valorisation agricole, les limons sont bien évidemment les sols les plus favorables : sur 60 % des sites étudiés, aucune contrainte agricole majeure n’apparaît. Conséquence logique, les deux tiers des parcelles sur limon profond sont labourés. Certains sols de limon peuvent cependant souffrir d’un excès d’eau, c’est le cas pour 20 % des sites, qui sont alors exploités en prairie.
L’argile à silex, terrain moins favorable, est assez fréquent, on la retrouve dans 18 % des sites étudiés. Elle se rencontre partout sauf dans le département de la Manche. Les sols sur argile à silex bénéficient souvent d’une couche de limon qui améliore la situation. Cependant, l’épaisseur de cette couche est très variable au sein des parcelles. La contrainte principale de ces terres reste donc les silex : ils sont pénalisants dans la moitié des cas. Deuxième contrainte, observée dans près de 40 % des sites sur argile à silex : l’excès d’eau. La couche d’argile imperméable située en profondeur empêche l’évacuation de l’eau, qui stagne. Les parcelles concernées sont la plupart du temps en prairies permanentes, ou dans certains cas drainées et labourées.
Les sols issus de schiste (12 % des sites) et de granite (6 %) sont spécifiques à l’Ouest de la région, le bocage bas-normand. Les sols de craie (8 % des sites) se rencontrent quant à eux uniquement à l’Est de la région, en Haute-Normandie, dans le Pays d’Auge et le Perche. Pour ces trois types de terrains le principal obstacle à l’utilisation agricole est l’abondance de cailloux, pour près de la moitié des sites. Les terres sur granite et sur craie sont généralement saines. Les sols sur schiste sont parfois pénalisés soit par l’excès d’eau (20 % des cas), soit à l’inverse par la faible réserve en eau des “petites terres” (20 % des cas également).
Acidification et tassement, risques principaux de dégradation des sols normands
En Normandie, l’acidification et le tassement sont en première ligne des menaces pesant sur la qualité des sols. Le risque d’acidification concerne plus de 40 % des sites, même si une partie est actuellement chaulée. Dans notre région, la tendance acide naturelle de la plupart des sols et la pluviométrie abondante entretiennent la baisse du pH. Même les sols sur craie peuvent être concernés, leur pH doit être surveillé.
Le tassement est la seconde cause de dégradation de la qualité des sols dans la région. Cela s’explique par l’abondance des sols limoneux, très sensibles à la compaction : limons éoliens, limons sur argile à silex, limons sur schiste… Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les phénomènes de tassement sont plus fréquents en prairie (deux tiers des sites concernés) qu’en labour. C’est généralement le piétinement par le bétail en période humide qui est en cause.
Les parcelles étudiées dans le cadre du réseau paraissent relativement indemnes des autres risques de dégradation des sols. La battance (“glaçage” en surface) concerne 11% des sites, l’érosion seulement 8 %. La diminution de la matière organique est un risque constaté uniquement dans 2 % des sites normands. Il est vrai que les prairies et les bois, larges pourvoyeurs d’humus, couvrent 60 % du réseau.
Reste à étudier le risque de contamination par des produits indésirables de type métaux lourds. Les résultats des analyses sur le réseau Normand feront l’objet d’un autre article courant 2008.
Laëtitia Chégard, Chambre d’Agriculture 50
Isabelle Diomard, Chambre d’Agriculture 14
Un réseau pour surveiller la qualité des sols
Les sols évoluent lentement sous l'effet du climat, de la végétation,... Néanmoins, leur évolution peut être accélérée par les activités humaines (aménagements fonciers, pollutions ac-cidentelles,....). Des processus, comme l'érosion ou l'acidifica-tion, qui n'affectent pas la production à court terme sont parfois néfastes à long terme. Aujourd'hui, l'Europe souhaite prendre en compte les sols dans les politiques environnementales. Afin d'évaluer l'état actuel des sols et surveiller leur évolution, les scientifiques ont décidé de suivre un réseau de parcelles. Une collaboration scientifique entre l'Inra et les Chambres d'agricul-ture depuis 2005 a permis de mettre en place ce réseau de mesures de la qualité des sols en Normandie.
Le réseau est mis en place sur la France entière avec 1 600 sites répartis sur un maillage de 16 km de côté. Ainsi, 108 sites couvrent la Normandie (voir carte). Les sites peuvent aussi bien se situer en culture, en prairie ou encore dans un bois. Les prélèvements de terre pour analyse (en surface et en profondeur) sont accompagnés d’une observation très détaillée en fosse et d’un questionnaire sur l’exploitation de la parcelle. Tous les résultats sont anonymes, ils sont intégrés dans la base de données nationale. Les échantillons de terre prélevés sont envoyés à analyser à l'Inra d'Orléans. Les analyses portent sur la granulométrie, le pH, les éléments fertilisants, les métaux lourds. Les mesures seront réalisées tous les 8 ans pour surveiller l'évolution des teneurs. L'objectif est de faire un bilan de la qualité des sols et de la suivre à long terme pour éviter leur dégradation (acidification, perte de fertilité…).
Un panorama des terres normandes
Le premier résultat de l’étude des 108 sites du réseau est un panorama détaillé des terres normandes, qui permet de mieux connaître les sols de la région (Graphique 1).
Dans le réseau, les sols de limons confirment leur importance en Normandie : on les retrouve dans près de 30 % des sites. Cependant, leur répartition est inégale, ils sont presque absents des sites de l’Orne. Du point de vue de la valorisation agricole, les limons sont bien évidemment les sols les plus favorables : sur 60 % des sites étudiés, aucune contrainte agricole majeure n’apparaît. Conséquence logique, les deux tiers des parcelles sur limon profond sont labourés. Certains sols de limon peuvent cependant souffrir d’un excès d’eau, c’est le cas pour 20 % des sites, qui sont alors exploités en prairie.
L’argile à silex, terrain moins favorable, est assez fréquent, on la retrouve dans 18 % des sites étudiés. Elle se rencontre partout sauf dans le département de la Manche. Les sols sur argile à silex bénéficient souvent d’une couche de limon qui améliore la situation. Cependant, l’épaisseur de cette couche est très variable au sein des parcelles. La contrainte principale de ces terres reste donc les silex : ils sont pénalisants dans la moitié des cas. Deuxième contrainte, observée dans près de 40 % des sites sur argile à silex : l’excès d’eau. La couche d’argile imperméable située en profondeur empêche l’évacuation de l’eau, qui stagne. Les parcelles concernées sont la plupart du temps en prairies permanentes, ou dans certains cas drainées et labourées.
Les sols issus de schiste (12 % des sites) et de granite (6 %) sont spécifiques à l’Ouest de la région, le bocage bas-normand. Les sols de craie (8 % des sites) se rencontrent quant à eux uniquement à l’Est de la région, en Haute-Normandie, dans le Pays d’Auge et le Perche. Pour ces trois types de terrains le principal obstacle à l’utilisation agricole est l’abondance de cailloux, pour près de la moitié des sites. Les terres sur granite et sur craie sont généralement saines. Les sols sur schiste sont parfois pénalisés soit par l’excès d’eau (20 % des cas), soit à l’inverse par la faible réserve en eau des “petites terres” (20 % des cas également).
Acidification et tassement, risques principaux de dégradation des sols normands
En Normandie, l’acidification et le tassement sont en première ligne des menaces pesant sur la qualité des sols. Le risque d’acidification concerne plus de 40 % des sites, même si une partie est actuellement chaulée. Dans notre région, la tendance acide naturelle de la plupart des sols et la pluviométrie abondante entretiennent la baisse du pH. Même les sols sur craie peuvent être concernés, leur pH doit être surveillé.
Le tassement est la seconde cause de dégradation de la qualité des sols dans la région. Cela s’explique par l’abondance des sols limoneux, très sensibles à la compaction : limons éoliens, limons sur argile à silex, limons sur schiste… Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les phénomènes de tassement sont plus fréquents en prairie (deux tiers des sites concernés) qu’en labour. C’est généralement le piétinement par le bétail en période humide qui est en cause.
Les parcelles étudiées dans le cadre du réseau paraissent relativement indemnes des autres risques de dégradation des sols. La battance (“glaçage” en surface) concerne 11% des sites, l’érosion seulement 8 %. La diminution de la matière organique est un risque constaté uniquement dans 2 % des sites normands. Il est vrai que les prairies et les bois, larges pourvoyeurs d’humus, couvrent 60 % du réseau.
Reste à étudier le risque de contamination par des produits indésirables de type métaux lourds. Les résultats des analyses sur le réseau Normand feront l’objet d’un autre article courant 2008.
Laëtitia Chégard, Chambre d’Agriculture 50
Isabelle Diomard, Chambre d’Agriculture 14